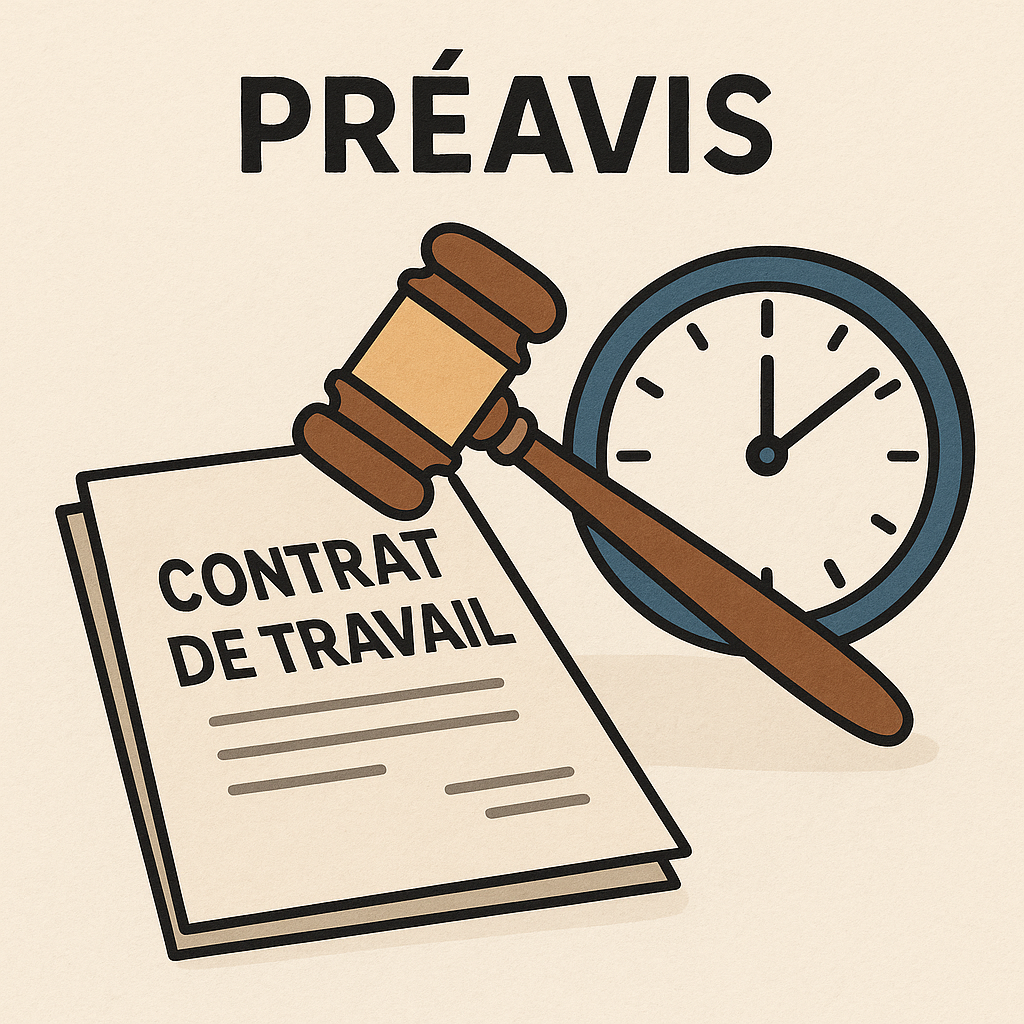
Le préavis de licenciement est une étape essentielle du processus de rupture du contrat de travail. Qu'il s'agisse d'un licenciement pour motif personnel ou économique, l'employeur doit, dans la majorité des cas respecter un délai de préavis permettant au salarié de préparer son départ et de rechercher un nouvel emploi. De son côté, le salarié continue de percevoir son salaire jusqu'à la fin de cette période.
Mais quelles sont les règles applicables en matière de de préavis ? Sa durée varie-t-elle selon l'ancienneté, la convention collective ou la catégorie professionnelle ?
Dans quels cas peut-il être raccourci, suspendu ou supprimé ? Et que se passe-t-il si le préavis n'est pas exécuté?
Un salarié peut-il quitter son poste du jour au lendemain ? Un employeur peut-il licencier sans prévenir ? Le salarié est-il obligé de travailler pendant son préavis ? Et peut-il être payé sans travailler ?
Le préavis répond à toutes ces questions puisqu’il encadre la fin du contrat de travail pour garantir une transition équilibrée entre salarié et employeur.
Le préavis en droit du travail est un délai que l’employeur ou le salarié doit respecter lorsqu’il décide de rompre le contrat de travail. Sa durée est fixée par la loi ou les conventions collectives.
L’employeur peut, s’il le souhaite, en dispenser le salarié. Pendant ce délai, les obligations contractuelles de travail restent inchangées. Le préavis concerne aussi bien la démission que le licenciement, mais ici, on s’intéressera surtout au préavis en cas de licenciement.
Le préavis de licenciement correspond au laps de temps entre la notification du licenciement et la fin effective du contrat de travail. Certaines formes de licenciement n’impliquent aucun préavis, comme en cas de faute grave ou lourde. En principe, le préavis s’exécute sans interruption, mais des aménagements sont possibles, notamment pour permettre au salarié de rechercher un nouvel emploi.
Sur le caractère obligatoire, le principe souhaite que lorsque le salarié a droit à un préavis de licenciement, il doit l’exécuter, sauf s’il en est dispensé ou s’il est dans l’impossibilité de le faire. Pendant cette période, le salarié continue de travailler normalement et perçoit sa rémunération habituelle.
Il existe cependant des exceptions à cette règle. Tout d’abord, l’employeur peut dispenser le salarié d’effectuer son préavis. Cela signifie que le salarié est explicitement autorisé à ne pas respecter cette période. Cette dispense ne modifie pas la date de rupture effective du contrat : le contrat prend fin à la date initialement prévue.
En revanche, l’employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis, qui correspond au salaire intégral que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période. Cette indemnité comprend notamment les primes habituelles et les heures supplémentaires couramment effectuées. Cette indemnité n’est toutefois pas due en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
La faute grave est une faute du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise durant la durée du préavis (ex : insubordination, abandon de poste). La faute lourde est une faute grave, mais aggravée par l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. Dans ces cas, le salarié n’a pas droit au préavis ni à son indemnité de licenciement.
L’employeur doit impérativement qualifier clairement la faute grave ou lourde. En effet, dans un arrêt du 27 mai 2025 (n°24-16-119), la Cour de cassation dans sa chambre sociale a cassé un arrêt de la Cour d’appel parce que l’employeur n’avait pas expressément mentionné la faute grave dans la lettre de licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et la qualification de faute grave doit y apparaitre clairement pour justifier l’absence de préavis.
Si l’employeur ne l’indique pas explicitement, le juge ne peut pas retenir la faute grave d’office, même si les faits le justifieraient objectivement. Ainsi, ici, la faute grave n’a pas été retenue car elle n’a pas été expressément mentionnée dans la lettre, ce qui donne droit au préavis.
Par ailleurs, d’autres situations excluent le préavis.
La Cour de cassation a aussi posé des limites à la renonciation anticipée au préavis. Dans un arrêt du 7 décembre 2022 (n°.21-16.000), elle précise qu’un salarié ne peut pas renoncer à son préavis avant la notification de son licenciement. Si, malgré tout, l’employeur accepte de dispenser le salarié avant cette notification, il doit lui verser l’indemnité compensatrice correspondante.
Le préavis débute à partir du jour où la lettre recommandée notifiant le licenciement est présentée pour la première fois au salarié, même si celui-ci ne l’a pas encore récupérée ou prise en main.
La durée du préavis dépend principalement du statut du salarié et de son ancienneté dans l’entreprise. Certaines catégories de salariés bénéficient de règles spécifiques, et le lieu habituel de travail peut aussi influencer cette durée.
En règle générale, plus un salarié a d’ancienneté, plus son préavis est long. De plus, la convention collective applicable à l’entreprise peut prévoir des durées spécifiques, souvent plus favorables que la loi.
De manière générale, il est important de noter que les conventions collectives, le contrat de travail ou les usages dans l’entreprise peuvent toujours prévoir des durées de préavis plus favorables pour le salarié.
En principe, la suspension du contrat de travail ne prolonge pas la durée du préavis de licenciement : celui-ci court sans interruption, de date à date, même si le salarié est absent ou que le contrat est suspendu. Cependant, il existe quelques exceptions ou le préavis peut être suspendu ou prolongé. La principale exception concerne les congés payés.
Par ailleurs, le préavis peut être suspendu ou reporté par accord entre l’employeur et le salarié, ou si la convention collective prévoit une telle possibilité.
De surcroit, pendant le préavis, l’employeur doit souvent permettre au salarié de s’absenter pour rechercher un nouvel emploi, si la convention collective ou les usages l’autorisent. En général, ces textes fixent un nombre d’heures d’absence autorisées à cet effet.
Enfin, il est important d’évoquer les risques liés au non-respect du préavis.
Pour l’employeur, ne pas respecter le préavis l’oblige à verser une indemnité compensatrice correspondant au salaire et aux avantages que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé durant cette période. De plus, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou en présence d’un autre préjudice, l’employeur peut devoir verser des dommages et intérêts supplémentaires.
Dans une décision du 2 juin 1999, la Cour de cassation a précisé que si un salarié est dispensé d’exécuter son préavis, les fautes découvertes après le licenciement ne peuvent pas justifier rétroactivement une faute grave. Autrement dit, même si le salarié a mal agi après la dispense, il doit quand même être payé pour le préavis non effectué.
Du côté du salarié, le non-respect du préavis l’expose à une sanction : il devra verser à l’employeur une indemnité équivalente à la durée du préavis non respectée. Cette règle connaît cependant des exceptions, notamment en cas de force majeure, d’accord de l’employeur ou de faute grave de ce dernier.
Pour que toute contestation relative au préavis soit recevable devant la justice, des délais de prescription doivent être respectés :
Passé ces délais, aucune action ne sera plus possible. Une question souvent posée concerne la possibilité de concilier la prise d’acte de la rupture avec l’exécution du préavis.
Dans un arrêt du 2 juin 2010, la Cour de cassation a affirmé que l’exécution volontaire, même partielle, du préavis par un salarié ayant pris acte de la rupture n’affecte pas l’examen de la gravité des manquements de l’employeur. Si la prise d’acte est justifiée, elle est alors assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l’indemnité compensatrice de préavis, y compris pour la période non effectuée.
Ainsi, le respect des règles entourant le préavis est un équilibre délicat, avec des enjeux importants pour les deux parties. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour éviter des conflits longs et coûteux, mais aussi pour garantir une séparation respectueuse et conforme au droit.
Maitre Zenou est présent pour vous défendre et assurer votre defense devant le Conseil de prud'hommes afin de faire respecter votre préavis en cas de licenciement ou de démission.
Le temps où un employeur pouvait, d’un simple clic en fin d’année, supprimer les jours de congés non pris d'un salarié semble définitivement révolu. Dans un arrêt capital rendu le 13 novembr...
Le ciel blanchit, les routes scintillent d’une couche de givre traîtresse et Météo-France vient de basculer votre département en vigilance orange « neige-verglas ». Tandis que les autorités dé...
Depuis le 1er janvier 2026, le marché du travail français connaît une mutation profonde avec l'entrée en vigueur effective du CDD de reconversion. Ce nouveau contrat, issu de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 (dite ...
Dans le tourbillon de l’économie de la "gig economy", du télétravail généralisé et de la consommation 24h/24, une règle semble appartenir à un autre siècle : l’interdiction de...
RÉALISATION DE VOS DOCUMENTS LÉGAUX
Faites réaliser tous vos documents juridiques par un professionnel...